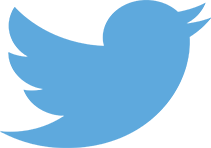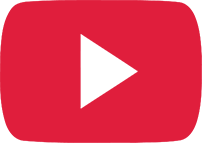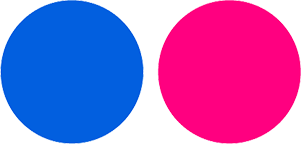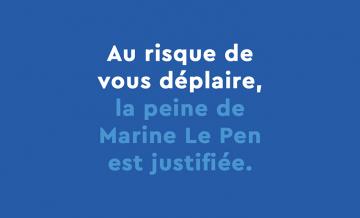Madame la présidente, madame la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité, mes chers collègues, notre groupe a voulu appeler l’attention de la représentation nationale sur le service minimum, devenu une réalité le 1er janvier 2008 alors que, il y a quelques années, on prétendait sa mise en œuvre impossible.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale répondait à une attente forte et ancienne des Français, puisque 70 % d’entre eux y étaient favorables, en particulier les plus modestes, qui sont souvent les plus pénalisés en cas de grève. Deux ans plus tard, il nous est donc apparu important de faire le point sur la mise en oeuvre effective de cette mesure.
Je rappelle tout d’abord que cette loi visait avant tout à concilier le droit de grève avec d’autres droits fondamentaux, eux aussi inscrits dans la Constitution : la continuité d’accès au service public, la liberté d’aller et de venir, la liberté du commerce et de l’industrie, et enfin la liberté du travail.
La loi repose donc sur l’idée que, en renforçant le dialogue social dans les entreprises de transport, les grèves pourront être, pour une large part, évitées ; en cas de grève ou de perturbation prévisible du trafic, elle fixe le cadre dans lequel le service doit être organisé. Elle se voulait ainsi une réponse aux graves dysfonctionnements constatés dans les transports publics à l’occasion de mouvements de grève, et était, de ce point de vue, nécessaire.
Le premier volet de la loi fixait les conditions dans lesquelles les entreprises devaient, avant le 1er janvier 2008, négocier avec les organisations syndicales de salariés. Le deuxième volet prévoyait quant à lui la mise en oeuvre d’un service garanti en cas de grève ou de perturbation prévisible des transports publics, ainsi que l’obligation, pour le salarié, de déclarer deux jours avant le début de la grève son intention d’y participer.
On note toutefois – et cela est important pour la suite – qu’aucune définition uniforme du service minimum n’a été retenue : cette définition varie selon les réalités du terrain, partant selon les mesures prises par les autorités de transport.
Le troisième volet, enfin, reconnaît le droit pour les usagers des transports publics d’être préalablement informés en cas de grève ou de perturbations prévisibles.
Six mois après sa promulgation, cette loi entrait en vigueur. Il est temps aujourd’hui, soit presque deux ans plus tard, d’en faire le bilan pour s’assurer de son effectivité et identifier les possibilités de l’améliorer. Un tel bilan a d’ailleurs été effectué en mars dernier par les députés Jacques Kossowski et Maxime Bono, dont le rapport faisait état d’une mise en oeuvre globalement satisfaisante, tant pour les mesures d’application prises par les entreprises de transport que pour le service assuré aux usagers et le dialogue social.
Il est vrai que les chiffres, sans les citer tous, appuient un tel constat : le nombre de journées perdues à la SNCF pour fait de grève en 2008 est le plus bas depuis quatre ans. À la RATP, le nombre de jours de grève par agent en 2008 était de 0,18. Enfin, en 2008, seuls 63 agents, sur un total de 3 051, n’ont pas respecté leur obligation légale de déclarer leur intention de faire grève.
Toutefois, on constate que cette loi comporte aussi un certain nombre de limites ; il convient de les souligner et d’en débattre. Des quais de gare ou des arrêts de bus surchargés, des clients laissés sans information qui attendent un train ou un bus qui ne viendra jamais : telle est la situation que nous voulions éviter, et qui s’est pourtant reproduite récemment, même si ce fut dans une moindre mesure qu’avant 2008. Voilà qui fait figure de paradoxe dans une France qui a pris le tournant de la modernité, à l’heure où le Grand Paris, par la reconfiguration de son réseau de transports, désenclave des territoires et des communautés et à l’heure où les usagers des services publics de transports deviennent de plus en plus des clients. Rappelons également, puisque la question du financement avait été débattue, que ce sont les mêmes usagers qui, par leurs impôts, financent ces entreprises.
Si l’exercice du droit de grève est légitime, certains excès sont de moins en moins bien supportés par nos concitoyens et entraînent une lassitude de l’opinion publique. Depuis plusieurs années, la population, toujours mieux informée, voit clairement que la grève n’est pas l’arme ultime des syndicats mais, souvent, le fait de corporatismes attachés à des intérêts catégoriels tirant leur force de négociation de leur capacité de nuisance collective.
Le service minimum doit, comme nous le voulions lorsque nous l’avons adopté, apporter une réponse concrète et pragmatique aux attentes quotidiennes de tous les Français, qu’ils soient Bretons ou Lorrains, qu’ils habitent Nice, Lille ou la région parisienne.
Le service minimum, en effet, ne concerne pas seulement l’Île-de-France, ni les seules SNCF et RATP : nous voulons qu’il soit appliqué sur tout le territoire national et concerne l’ensemble des opérateurs de transport, dans l’intérêt des usagers.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Je commencerai par souligner les problèmes liés aux grèves massives. Quelle lecture, madame la secrétaire d’État, peut-on faire du service minimum lorsque 90 à 95 % des personnels se mettent en grève, comme ce fut le cas au mois de décembre sur la ligne A du RER, grève qui fut la plus suivie depuis 1995 ? Quelle lecture faire du service minimum lorsqu’un train sur deux circule jusqu’à dix-neuf heures trente seulement, obligeant la plupart des usagers à avoir recours à leur voiture ensuite ? Quelle lecture peut-on faire d’un tel dispositif, à l’heure ou le débat sur le Grenelle II s’engage ?
Le Gouvernement ne devrait-il pas, en accord avec les syndicats, mettre en oeuvre une procédure applicable dans de telles circonstances, afin d’apporter une réponse appropriée et proportionnée pour éviter la paralysie du trafic ?
La difficulté est encore amplifiée à l’occasion des grèves de cinquante-neuf minutes ou des grèves spontanées, dites émotionnelles, déclenchées à la suite d’une agression : c’est d’ailleurs l’une des failles de la loi.
Enfin, la loi instaure un dialogue social qui préfigure les règles applicables en faveur des usagers. Mais où est le dialogue social lorsque, suite à la grève du RER A de décembre dernier, les responsables syndicaux avouent que la prolongation du mouvement est motivée par les élections syndicales ?
Le bilan, globalement positif, de l’application du texte ne signifie donc pas que tout va bien. On a d’ailleurs pu s’apercevoir, en décembre dernier, que les usagers avaient une perception toute différente lorsque le service public des transports subissait une grève. Même si la loi, telle qu’elle a été votée, est correctement appliquée, même si les salariés en ont compris le rôle et même si les usagers en apprécient les avantages, les circonstances ont révélé certaines limites.
La loi n’est donc pas suffisante pour garantir le droit constitutionnel de la liberté de circulation et d’accès aux services publics. Or, permettez-moi d’y insister, le respect dû aux usagers est constitutionnellement reconnu à travers la continuité du service public. Par ailleurs, ne l’oublions pas, la Constitution précise que le droit de grève s’exerce dans le cadre de la loi. Il ne s’exerce donc pas de manière uniforme, mais en fonction du domaine d’activités auquel il s’applique. Ainsi, en France, il existe un service minimum dans les établissements et les organismes de radiodiffusion et de télévision, les établissements détenant des matières nucléaires, le contrôle de la navigation aérienne et la santé. Pourquoi pas dans les transports terrestres, qui concernent quotidiennement des millions de personnes ?
Il ne s’agit pas de remettre en cause le droit de grève, mais de tenir compte des usagers du service public, que l’on ne peut marginaliser et laisser au bord des quais, d’autant plus qu’ils sont souvent les moins favorisés de nos concitoyens.
Nous proposons la mise en oeuvre d’un droit de réquisition, lequel, pour n’être pas frappé d’inconstitutionnalité, appelle une modification de la Constitution. En 1987, le Conseil constitutionnel a en effet considéré qu’il appartenait au législateur d’apporter au droit de grève les limitations nécessaires pour assurer la continuité du service public, et que « ces limitations peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ». Il s’agit donc, mes chers collègues, de définir ce qui, à nos yeux, est indispensable pour nos concitoyens.
Parallèlement, et parce que le dialogue social n’en revêt pas moins une importance de tout premier ordre à nos yeux, nous proposons, sur la base des excellentes propositions contenues dans le rapport de M. Kossowski, que les mécanismes de dialogue social soient poussés plus avant. À cet effet, la création d’un observatoire des relations sociales dans les transports terrestres, appelé à faire un bilan de l’état du dialogue social dans notre pays, nous semble très opportune.
Par ailleurs, pour parer aux grèves émotionnelles et aux arrêts de travail immédiats, il est essentiel que l’amplification de la rumeur ne tienne pas lieu d’information, et que les agents victimes d’une agression soient pris en charge de la façon la plus efficace possible.
C’est là le seul moyen d’empêcher la réédition de ce qui s’est passé à la gare Saint-Lazare. Préparer du mieux possible les conducteurs à des situations tendues constitue également une piste intéressante.
Enfin et surtout, pour que les excellentes mesures déjà prises et appliquées sur l’ensemble du territoire soient homogènes, il est essentiel de continuer les négociations d’accords cadres dans les entreprises du secteur des transports, notamment celles du transport interurbain.
Des négociations collectives doivent aussi être engagées dans toutes les entreprises qui relèvent du champ de la loi, afin que le service du retour soit aussi bien assuré que celui du matin : il y va du respect des usagers, qu’il n’est pas admissible d’abandonner au milieu du trajet.
Après avoir ainsi brossé quelques pistes d’amélioration, le groupe Nouveau Centre souhaite connaître la lecture du Gouvernement quant à la mise en oeuvre de la loi, et les possibilités d’amélioration qu’il envisage pour assurer le service minimum qu’il a promis à nos concitoyens.
Je vous remercie.